Venise Gosnat est né le 30 novembre 1887 à Bourges.
Son père et sa mère étaient respectivement ouvrier charpentier, ancien compagnon, et couturière. Ses parents avaient 32 ans à sa naissance, mais il fut orphelin très jeune, son père mourant à 34 ans et sa mère à 36 ans, ses deux parents mourant des suites de maladie contractées à cause notamment d'un travail harassant pour nourrir leurs quatre enfants. Venise va être accueilli par ses grands-parents maternels, humbles travailleurs de la terre, et ne peut en raison de leur pauvreté fréquenter l'école communale de manière très assidue. Venise est berger toute une partie du temps scolaire. Il sert aux offices religieux dans son village d'Asnières-les-Bourges et assiste au catéchisme, ses grands-parents étant catholiques pratiquants.
Le certificat d'études primaire obtenu, Venise se fait embaucher pour aider ses grands-parents comme manœuvre aux établissements "Le Panama", fabrique de sellerie, de bourrellerie, de cordonnerie. Il y apprend à travailler le cuir. Ses sœurs Rachel et Clélie deviennent religieuses à Bourges. Clélie décède de maladie au début de la guerre 14-18. Venise Gosnat a 27 ans au déclenchement de la Grande guerre.
Adhérent de la CGT depuis 1907, membre du Parti Socialiste (SFIO) depuis 1911, il est marqué au carnet B comme "rouge" dangereux depuis les années 1908-1910. A l'époque, quoique artisan cordonnier de formation, il travailleur comme poseur de lignes pour les PTT. Venise, grand admirateur de Jaurès, accepte difficilement le ralliement des cadres socialistes, y compris Jules Guesde et Edouard Vaillant, en août 1914, à l'Union Sacrée. Pendant la guerre, il est mobilisé à l'arsenal de Bourges. Après la révolution russe de février, en juin 1917, 1700 ouvriers de l'arsenal de Bourges font grève pour des augmentations, plus de jours de repos et aussi avec des mots d'ordre politique contre la guerre. Venise, organisateur du mouvement syndical, a été éloigné de l'Arsenal de Bourges et du Cher, et renvoyé au front en mai 1917. Durant cette deuxième période au front, Venise fut gazé, commotionné par une bombe qui le projeta en l'air, lors d'une mission de ravitaillement, et eut le tympan crevé.
En novembre 1917, il adhère à l'Association Républicaine des Anciens Combattants qu'ont fondé Henri Barbusse, Paul Vailland-Couturier, Raymond Lefebvre, Georges Bruyère.
La révolution d'Octobre stimule le mouvement ouvrier. 100 000 métallurgistes font grève le 1er mai 1918 malgré la décision de la CGT, dirigée par Jouhaux, de ne pas chômer ce jour-là. A Bourges, le mot d'ordre de Jouhaux ne sera pas suivi. Les dragons à cheval sont lancés contre les hommes et les femmes qui défilent en chantant "l'Internationale" et en criant "A bas la guerre, vive la paix!". Venise est toujours mobilisé au 1er Parc d'Artillerie comme soldat et rêve de revenir à l'arsenal pour agir politiquement. A sa démobilisation, en avril 1919, il intègre l'Arsenal de Bourges mais est révoqué en 1922 pour lui faire payer son action syndicale et politique dans l'entreprise et dans le département du Cher.
Venise a choisi la IIIe Internationale pendant et à l'issue du Congrès de Tours et il est un membre actif du Parti Communiste. Il est très actif dans les grèves de 1920 dans le Cher et cherche à empêcher, en vain, la division syndicale. En 1923, il préside le congrès extraordinaire de la CGTU à Bourges. En 1925, Venise Gosnat est réintégré sous conditions à l'Arsenal et prend part à l'action de propagande contre la guerre coloniale du Rif au Maroc et aux grèves politiques de l'Arsenal contre cette guerre.
En décembre 1925, le Parti communiste appelle Venise à Paris et celui-ci l'encourage à s'embaucher comme forgeron aux Ateliers de Suresnes pour y mener la bataille politique et syndicale, puis aux forges de Clichy, dépendant de la société anonyme André Citroën.
Venise est actif dans le mouvement social de solidarité avec l'Espagne Républicaine, pour le Front populaire et les conquêtes sociales de 36, il dénonce les accords de capitulation anglo-française face à l'impérialisme nazi de Munich. Seuls au Parlement, les 72 députés communistes et deux autres parlementaires votèrent contre la ratification de ce honteux traité.
Pendant la drôle de guerre, Venise Gosnat vit la persécution contre les communistes après le pacte germano-soviétique à Ivry, la circonscription où Maurice Thorez est élu député. Venise est président de l'office du logement social H.B.M à Ivry et travaille à la mairie en même que le secrétaire de la Région du Parti Communiste Clandestin.
Son fils et celui d'Alice, son épouse, Georges est mobilisé. Il ne reverra sa famille qu'après la victoire du 8 mai 1945, et 5 ans de captivité... Georges était officier, sous-lieutenant de réserve, et Maurice Thorez lui avait confié la responsabilité de la Compagnie "France-Navigation" qui ravitaillait en vivres et en armes l'Espagne républicaine avec 22 navires et 2000 marins. Cette compagnie effectuera aussi plusieurs transports de réfugiés républicains espagnols en Amérique Latine.
Alors que "Ce soir", "L'Humanité" sont interdits depuis le 27 août 1939, Venise Gosnat fait tirer l'Huma clandestine et les tracts du PCF à partir d'octobre-novembre 1939 dans les bureaux de l'office H.B.M de Vitry. Venise est déchu officiellement de son mandat de maire-adjoint de Vitry le 21 janvier 1940, mais garde curieusement ses fonctions de président de l'office public H.B.M de Vitry.
En mai 1940, néanmoins, Venise est arrêté, embarqué au camp du Baillet en Seine-et-Oise à destination de l'Ile d'Yeu. Venise décide de s'évader à la première occasion avec André Marrane, frère de Georges Marrane, maire d'Ivry. L'évasion de la prison de Riom réussie a lieu le 24 octobre 1940 à l'occasion d'une corvée en forêt. Venise Gosnat et André Marrane rejoignent Bourges, puis Paris.
A Paris, il fut demandé à Venise de prendre quelques semaines de repos avant de succéder à Marcel Paul, comme responsable de l'Inter 4, c'est-à-dire de la Bretagne.
Venise Gosnat va réorganiser l'action de résistance des communistes en Bretagne (les cinq départements, y compris donc la Loire-Inférieure) pendant deux ans, de décembre 1940 à décembre 1942. Dans un aussi vaste territoire, l'INTER PR 4, il fallait mettre en place des directions efficaces par départements, ou par secteurs de départements, dans les villes et les campagnes. Venise sera le fondateur du Front national et des premiers groupes de Francs Tireiurs et Partisans français dont il jeta les bases dès le début de 1941.
C'est Venise Gosnat qui met en place le service de liaisons avec les internés du camp de Châteaubriant et organise entre autre les évasions retentissantes de Léon Mauvais, Fernand Grenier, Eugène Hénaff, Henri Reynaud, tous membres du Comité central du PCF. Le Front National prend naissance en Loire-Atlantique avec des personnalités du Parti socialiste et du Parti radical.
La fiche de signalement de la Gestapo et de la police de Vichy indique sur Venise Gosnat, le responsable du Parti Communiste clandestin en Bretagne:
"Vieux Georges, alias Pitard Georges, taille 1,80 m; 55 ans environ; cheveux grisonnants; légère calvitie frontale, assez forte corpulence, parfois des lunettes, se sert d'une canne canée; médaille du Travail, responsable politique inter-région. Doit se trouver en liaison directe ou faire partie du Comité central du parti communiste".
En réalité, Venise Gosnat se faisait appeler "Pichart" et non "Pitard".
Pierre Corre, qui sera fusillé ensuite avec 18 autres camarades, de l'arsenal de Brest, le convainc de rentrer à l'arsenal de Brest, occupé par les Allemands pour recruter et encourager à la Résistance. Après son départ, 5 des 7 transformateurs électriques de l'arsenal ont sauté. Une des planques bretonnes de Venise Gosnat se trouve à Brest, rue de Bohar, actuellement rue du Commandant Drogou. Il avait d'autres planques, à Nantes, Saint-Nazaire, et Quimper.
"Toutefois, Brest et le Finistère, souligne Jean Chaumeil, furent au centre de l'action générale dirigée par Venise Gosnat. Il y a laissé un très grand nombre d'amis, sans oublier les familles et dizaines de compagnons d'armes fusillés ou déportés dans les camps de la mort".
Pendant ce temps, Venise Gosnat vit comme un grand-père tranquille en apparence avec sa petite-fille, Raymonde, la fille aînée de son fils, en captivité, à qui il apprend à lire et à écrire, alors que sa mère a été arrêtée par la Gestapo.
Envers et contre tout, l'action dirigeante de Venise se poursuivit de plus belle en Bretagne. Jean Chaumeil a retrouvé dans ses archives personnelles une:
lettre adressée par Venise Gosnat à Corentin André, alors responsable des Anciens résistants en Côtes-du-Nord, datée du 11 mars 1963:
"(...) J'ai été envoyé fin décembre 1940 à Nantes, comme inter-régional politique, avec mission d'achever la réorganisation du Parti dans les cinq départements bretons. Sous le nom de Georges Pichard ou Georges tout simplement, j'étais accompagné de ma femme et de la petite fille endimanchée dont parle Fernand Grenier dans son livre "C'était ainsi".
Je parcourais seul la Bretagne tous les mois, pendant une vingtaine de jours, ayant des rendez-vous avec les responsables...
Mon séjour en Bretagne se prolongea jusqu'à la fin 1942. Dénoncé et traqué pendant plusieurs jours dans le Finistère, je fus généreusement aidé pour m'échapper, par le patron du Bar de l'Arrivée à Quimper, le jeune Bernard, également de Quimper, à qui sa mère, téléphoniste, avait donné les renseignements communiqués à toutes les autorités policières et allemandes, et enfin par le vaillant camarade David, de Huelgoat.
A noter que c'est à Nantes que j'avais pris contact, au début de ma mission, avec les camarades du département, dans des conditions qui faillirent tourner au tragique. Un camarade devait me présenter dans un café du Petit-Chantilly. Ce camarade étant en retard, je me trouvais seul dans la salle. Une jeune femme vint me demander ce que je voulais. Je commandais une consommation qu'on ne me servait pas. Enfin le camarade arrive, et tout s'éclaira. Les responsables, qui m'avaient pris pour un flic, étaient dans une salle à côté, et s'apprêtaient à me liquider.
C'est donc dans ce café du Petit-Chantilly que je pris contact avec Robert Ballanger qui, après être passé par la Loire-Atlantique, son département, fut responsable du Finistère, puis d'Ille-et-Vilaine, avant d'être rappelé à des fonctions plus importantes dans la région parisienne; avec Pierre Charrier, fusillé dans la Gironde; Jean Vigneau, tué au combat dans les FTPF et sa soeur Zazeth Le Guyader, dont le fils, tué au combat dans la Côte-d'Or, à l'âge de 16 ans, repose avec son oncle Jean Vigneau au cimetière d'Ivry, au milieu des héros de cette localité de banlieue; puis avec Millot, professeur, fusillé, et sa femme actuellement institutrice à Paris, qui devait être chargée, avec le dentiste de Châteaubriant, de mettre au point l'évasion de nos camarades Fernand Grenier, Léon Mauvais, Henri Reynaud et Eugène Hénaff; Marcelle Baron, la boîte aux lettres, déportée par la suite; Georges Divet, qui a été maire-adjoint du 14e arrondissement de Paris, avant la révocation de tous nos représentants dans les mairies de Paris, par le gouvernement; les frères Hervé, fusillés; Trovallet, le courageux boulanger de Treffieux; les trois frères Delouche, de Saffré et Notre-Dame-des-Langueurs; Le Goff de Nort, mort des suites des tortures; et de Nantes encore: les camarades Pinard, Joseph, Auvin, Marrec, Tintin; les responsables de Saint-Nazaire, dont j'ai toujours ignoré les noms, qui firent un magnifique travail, en liaison avec les Républicains espagnols, etc., etc.
Dans les Côtes-du-Nord, le responsable était Le Quennec, qui devait par la suite organiser et diriger les FTPF de l'inter-région, Le Hénaff, de Guingamp, Marzin de Lannion, et quantité d'autres anonymes (pour moi) qui participaient à l'action. A Paimpol, habitait notre cher Marcel Cachin à qui je rendis visite au nom du Parti.
En Ille-et-Vilaine, Robert Ballanger dirigeait l'action avec Antoine et un bon camarade qui, après la guerre, fut secrétaire de l'Union des syndicats.
Dans le Morbihan, le camarade Lelay, ancien secrétaire de la mairie de Concarneau que nous avions affecté dans le Morbihan par mesure de sécurité, et qui fut reconnu et arrêté par l'ancien commissaire de police de Concarneau, lui aussi muté dans ce département; le camarade Conan, cheminot d'Auray, arrêté à la suite d'une fouille dans les placards du dépôt, fusillé; Marie Le Fur, d'Hennebont, un autre cheminot d'Auray, mari d'une institutrice d'un village voisin, un imprimeur de Pontivy et de nombreux inconnus.
Dans le Finistère, le camarade Larnicol, ancien maire de Léchiagat, resté fidèle au Parti, le jeune et courageux Albert Abalain, fusillé, sa tante Jeanne Goasguen, adjointe au maire de Brest après la Libération, Pierre Corre, ouvrier de l'arsenal de Brest et organisateur de la lutte au sein de l'Etablissement, mort au combat par la suite, la camarade Salou, déportée; Le Nedelec; Georges Abalain; Cadiou (Charlot); le camarade et la camarade Lijour (déportée) de Concarneau; David, de Huelgoat, mort au combat; Guyomarch, aujourd'hui capitaine, qui faussa compagnie aux gendarmes alors qu'il avait les menottes aux mains; François et sa mère, bouchers à Scaër, les frères Le Pape, de Pont de Buis, Jojo (?), pêcheur de Douarnenez, une sabotière de Rosporden, Bernard, de Quimper, et sa mère, le cheminot Halle (je crois) de Quimper, fusillé, et beaucoup d'autres...".
Près de 1000 patriotes communistes sont ainsi organisés par le parti en 1941 et 1942 dans les cinq départements bretons, par groupes de trois, sans compter les nombreuses liaisons avec d'autres organisations, notamment le Front National.
"Un des premiers coups de main, écrit toujours Goisnat à Corentin André, fut dirigé sur les carrières de Pelerin, en Loire-Atlantique, ce qui nous procura de la dynamite pour les cinq départements. L'approvisionnement fut assuré par la suite par les pêcheurs de Concarneau, Léchiagat, Douarnenez, qui récupéraient en mer les tonnelets amenés par les Anglais; Marcel Paul était venu sur place donner des leçons d'utilisation de la dynamite. A partir de ce moment-là, la destruction des pylônes et des foyers de locomotives fut permanente et à grande échelle.
A Saint-Nazaire, un prototype d'hydravion sévèrement gardé, est pulvérisé le jour même où il devait être essayé.
A l'arsenal de Brest, tous les transformateurs, sauf deux, sautent le même jour, paralysant l'arsenal pendant plusieurs jours.
A Pont-de-Buis, le téléphérique de la poudrerie saute.
A Brest, des navires et des sous-marins furent immobilisés pendant des mois, parce qu'il était impossible aux Allemands de faire provision d'eau potable, toutes les analyses étant mauvaises, malgré les précautions les plus strictes.
Un jour d'été, à 18 heures, en pleine ville à Brest, au moment où des milliers de personnes étaient dans la rue, un acte d'une audace inouïe fut accompli: une petite bonne femme, la camarade Salou, avec de gros boulons, fit voler en éclats les glaces de la devanture du bureau d'embauche allemande (à proximité de la préfecture maritime), traversa la rue, et gagna tranquillement la rue Pasteur, protégée par un groupe armé de grenades qui n'eut pas à intervenir. L'opération qui avait duré deux à trois minutes, fut spectaculaire et mobilisatrice pour les masses laborieuses de la ville.
A Nantes, un petit groupe alla chercher le jeune Hervé, arrêté, dans le cabinet du juge d'instruction, abattant ce dernier. En octobre 1941, le chef de la Kommandantur fut tué et une terreur sans nom s'abattit sur la région: exécution de 27 camarades à Châteaubriant et 21 à Nantes.
"Il faudrait un volume" écrit Venise "pour retracer tous les actes des patriotes bretons. Les cheminots de toutes les grandes gares continuellement sur la brêche, les pêcheurs, avec leurs actions périlleuses en mer; les pompiers de Nantes, qui ne sont pas responsables si Doriot leur a échappé au Théâtre Graslin; les groupes qui faisaient flamber la paille réquisitionnée, les actes individuels, etc, etc.
Population magnifique où j'ai été fraternellement accueilli pendant les années 1941-1942, dans des centaines de maisons, avidement questionné pendant une partie de la nuit, lumières éteintes, d'où je repartais le matin avec une provision de crêpes. J'ai gardé de cette époque un souvenir inoubliable...."
Le 12 janvier 1969, Venise Gosnat est venu à la Maison du Peuple de Brest rendre hommage aux 19 fusillés brestois du 17 septembre 1943 au Mont Valérien (après leur jugement par le tribunal militaire de Rennes en décembre 1942 et par le Conseil de guerre allemand).
La femme de Venise, Alice née Morand, parcourt elle aussi la Bretagne et le Finistère, recherchée elle aussi par la police française, privée de carte d'alimentation comme Venise Gosnat. Elle a participé à de nombreuses distributions de tracts anti-allemands dans le secteur de Brest entre janvier 1941 et la fin de l'année 42 et a organisé durant toute la période de 41 et 42 les femmes patriotes du Finistère pour protester contre l'insuffisance du ravitaillement et contre la vie chère. Elle a dirigé une manifestation de ménagères en 1941 et deux au début de 1942. Pierre Berthelot de Brest a témoigné de ses activités de résistance après la guerre.
Fin 1942, le Parti Communiste rappelle à Paris Venise Gosnat, qui vient d'échapper de peu à une arrestation, avec Alice et Raymonde, leur petite-fille. Jacques Duclos lui confie la responsabilité du choix et de la sécurité des cadres sous la direction de Jean Chaumeil. Des milliers de documents sont passés entre les mains de Venise Gosnat qui, s'ils étaient tombés aux mains de l'Etat français d'extrême-droite, ou des Allemands, auraient conduit à des rafles monstres. En août 44, Venise fut nommé président du Comité de Libération d'Ivry, puis premier adjoint au maire d'Ivry sous la direction de Georges Marrane avec lequel il va mettre en place un plan de construction de 5000 logements sociaux.
Venise Gosnat est décédé en 1970.
Extraits de Venise Gosnat par Jean Chaumeil, éditions sociales, 1975 (exemplaire dédicacé à Pierre Le Rose, ancien résistant communiste de Concarneau, par Jean Chaumeil)
Lire aussi:

/image%2F1489059%2F20230703%2Fob_d3a7c7_capture-d-ecran-2023-07-03-a-19-07.png)





























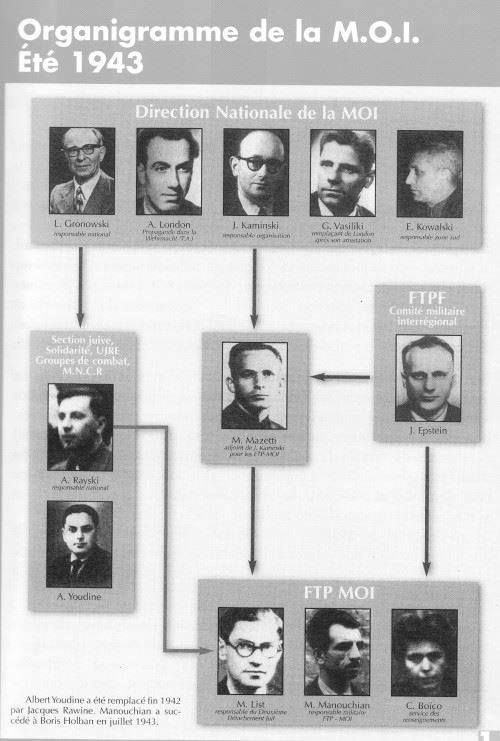


/image%2F1489059%2F20190306%2Fob_5329c2_pcf-section-de-morlaix.jpg)
