
Les réformes des retraites instaurées voilà plus de 15 ans ont grevé le système par répartition, faisant fondre le montant des pensions. Au point que l’indigence des retraités est devenue outre-Rhin l’un des sujets les plus sensibles du débat public.
« J e me fais un sang d’encre. Je ne dors plus la nuit. » La Berlinoise Inge Vogel, qui travaille encore pour quelques mois dans une société spécialisée dans le matériel paramédical, s’apprête à prendre sa retraite. « J’ai plein de projets et je sais que je ne manquerai pas d’activités diverses dans le domaine politique ou culturel », précise-t-elle pour bien indiquer que ce n’est pas du blues classique du nouveau retraité dont elle souffre. Non l’angoisse d’Inge Vogel tient au brutal décrochage annoncé de son niveau de vie dès lors qu’elle sera pensionnée. À l’aube de sa cessation d’activité, Inge (66 ans) touche un salaire correct, environ 2 500 euros net par mois. Ce revenu va être réduit de plus de la moitié, compte tenu de l’évolution outre-Rhin du taux de remplacement (la différence entre le dernier salaire net et le montant de la première pension). Ce qui va ramener ses revenus à environ 1 200 euros, soit tout juste au-dessus du niveau du salaire minimum. « Et je ne suis pas la plus à plaindre », lâche la bientôt ex-salariée. Quelqu’un payé aujourd’hui 1 500 euros net – « ce n’est malheureusement pas une rémunération exceptionnellement basse ici », précise Inge – ne va plus percevoir qu’un peu plus de 700 euros par mois pour ses vieux jours. « Une misère. » Et l’ex-assistante médicale ne mentionne même pas le cas de ses compatriotes innombrables qui ne toucheront pas le taux plein car ils n’auront pas accompli les exigibles 45 à 47 annuités.
Des mesures ressemblant à celles déployées par Emmanuel Macron
L’extension de la pauvreté chez les seniors et la perspective généralisée de retraites peau de chagrin provoquent un tel traumatisme dans la société allemande que ces thèmes figurent parmi les sujets les plus sensibles, régulièrement en première ligne du débat public. Les réformes lancées en 2002 et 2005 par l’ex-chancelier Gerhard Schröder furent présentées comme « le seul moyen de sauvegarder » le système et singulièrement la retraite de base par répartition dont l’écrasante majorité des Allemands demeure tributaire aujourd’hui. Encouragement fiscal aux plus riches à souscrire des assurances privées, amélioration de la compétitivité d’entreprises qui crouleraient sous les « charges sociales », instauration d’un indice dit de « durabilité » (Nachhaltigkeit) permettant de faire évoluer la valeur du point sur lequel est calculé le montant des retraites versées par les caisses légales (Gesetzliche Kassen) par répartition, allongement de la durée du travail et report à 67 ans de l’âge de départ à taux plein : la panoplie des mesures adoptées par le gouvernement SPD-Verts de l’époque ressemble à s’y méprendre à celle déployée aujourd’hui par Emmanuel Macron pour justifier sa réforme. Jusqu’aux éléments de langage sur « la nécessité absolue de moderniser le système ».
Pour se faire une idée des effets pratiques à moyen terme de la réforme des retraites d’Emmanuel Macron, il suffit ainsi de jeter un œil de l’autre côté de la frontière. Le bilan social des transformations allemandes, plus de quinze ans après leur entrée en vigueur, est dévastateur. La part des retraités allemands, précipités sous le seuil de pauvreté, a explosé. 16,8 % des seniors sont touchés aujourd’hui. Un retraité allemand sur deux – soit quelque 8,6 millions de personnes – doit survivre avec une pension inférieure à 800 euros par mois. Une enquête prospective publiée en septembre dernier par l’institut de recherche économique de Berlin (DIW) montre que plus d’un retraité sur 5 (21,6 %) sera misérable à l’horizon 2039. Et cette estimation est sans doute très optimiste puisque les auteurs de l’étude ont choisi de se baser sur la poursuite bon an mal an de la conjoncture économique favorable de ces dernières années (avec taux de chômage réduit).
L’introduction de la retraite Riester par capitalisation, présentée comme le troisième pilier du « modèle » germanique, a profondément ébranlé le système de base par répartition. Les placements réalisés par les citoyens généralement les plus aisés, attirés par d’alléchantes incitations fiscales, ont mécaniquement asséché les ressources des caisses légales qui organisent le financement solidaire des retraites par les cotisations des salariés actifs. Le manque à gagner sera d’autant plus conséquent qu’une partie des fonds est déjà drainée vers les retraites « maison » des entreprises, particularité ancienne du « modèle » et deuxième pilier du système reposant sur la capitalisation. Sachant qu’à ce titre seule une minorité de salariés appartenant le plus souvent aux plus grands groupes bénéficie aujourd’hui d’une rente complémentaire digne de ce nom.
La peur que le passage au troisième âge rime avec un rapide déclassement social, hante toute une société. Si bien que la question s’impose outre-Rhin depuis plusieurs années tout en haut du débat public. La grande coalition a dû bricoler des pare-feu en catastrophe pour éviter un emballement de la mécanique enclenchée par les réformes. On a suspendu d’ici à 2025 l’effet de l’indexation de la valeur du point de la retraite par répartition sur le montant des pensions en bloquant jusqu’à cette date à 48 % un taux de remplacement. Celui-ci avait dégringolé de plus de 10 % sur les dix dernières années.
Les travailleur pauvres grossissent le flot des retraités miséreux
CDU et SPD se sont mis aussi laborieusement d’accord sur l’introduction d’une retraite plancher (Grundrente), une revalorisation des pensions soutenue par l’État pour qu’elles atteignent le niveau des… minima sociaux (de 600 à 900 euros par mois). La mesure est censée éviter à nombre de retraités pauvres de prendre le chemin humiliant du bureau d’aide sociale pour toucher un complément de revenu pour accéder au minimum vital. Beaucoup préfèrent en effet effectuer n’importe quel petit boulot plutôt que d’avoir à mendier une aide. Là encore les chiffres des études les plus récentes sont aussi éloquents qu’effarants : plus d’un million de seniors, souvent âgés de plus de 70 ans, sont contraints aujourd’hui d’exercer des « mini-jobs » pour survivre. Soit une hausse d’environ 40 % sur dix ans. On les voit de plus en plus fréquemment dans les rues allemandes, ombres furtives qui distribuent des prospectus publicitaires, portent des journaux à domicile ou ramassent à la sauvette des canettes de verre ou de plastiques à la terrasse des cafés dans l’espoir de récupérer des consignes pratiquées sur ces produits outre-Rhin un maximum de centimes.
Cette pauvreté qui se répand si massivement chez les seniors allemands n’est pas sans lien avec l’extrême précarité imposée à de nombreux salariés par les lois Hartz de dérégulation du marché du travail. Lancées au même moment que les réformes des retraites, elles ont été présentées de la même façon qu’elles comme une étape majeure pour propulser « la compétitivité » (financière) des firmes allemandes. Les travailleurs pauvres, ou ceux dont la carrière a été entrecoupée de longues périodes de travaux sous-rémunérés et le plus souvent exonérés de cotisations sociales, contribuent évidemment à faire grossir le flot des retraités miséreux. Là encore, le parallèle avec la logique macronienne est frappant. L’aménagement au forceps du Code du travail décidé au début du quinquennat accroît la précarité, ce qui va accentuer l’appauvrissement programmé de la majorité des salariés par la réforme française des retraites.
Les effets contre-productifs des réformes antisociales engagées outre-Rhin au début de la décennie 2000 deviennent de plus en plus manifestes. L’apparition d’une société cloisonnée, devenue très inégalitaire, où « l’ascenseur social ne fonctionne plus », est dénoncée de plus en plus régulièrement dans les travaux de plusieurs économistes. Un handicap profond qui n’est pas sans lien avec l’entrée en stagnation, depuis quelques mois, de la première économie de la zone euro.
Bruno Odent
commenter cet article …

/image%2F1489059%2F20230703%2Fob_d3a7c7_capture-d-ecran-2023-07-03-a-19-07.png)



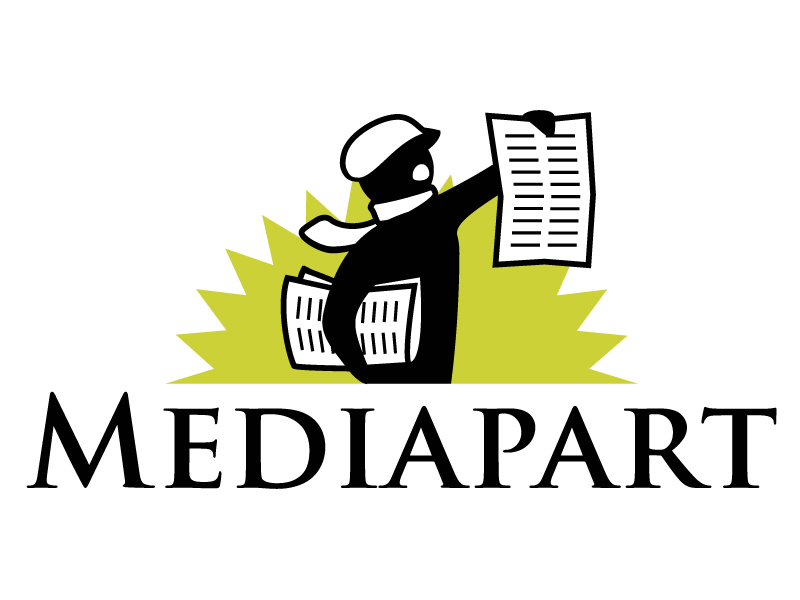










/image%2F1489059%2F20190306%2Fob_5329c2_pcf-section-de-morlaix.jpg)
