Le plan d’assassinat de la République par le noyau dirigeant du capital financier
La solution fasciste est couramment décrite comme « contre-révolution préventive » contre un péril rouge qui aurait épouvanté les classes dirigeantes, notamment en Italie et en Allemagne (Pierre Milza, Les fascismes,1991). De fait, après leurs rudes émotions de 1917-1919 (1920 au plus tard), celles-ci perçurent partout, France incluse, que la révolution n’aurait hors de Russie aucune chance à court ou moyen terme. Si haïe et « assiégée », de sa naissance à sa mort, qu’eût été la « forteresse » soviétique, ce n’est pas le péril révolutionnaire qui incita le noyau dirigeant du capital financier à abattre des structures politiques qu’il contrôlait pourtant presque autant que l’économie. La Banque de France, club de la haute banque privée, exerçait en effet depuis sa naissance (1802) – cadeau de Bonaparte aux bailleurs de fonds de son coup d’État du 18 brumaire – un pouvoir dictatorial sur tous les gouvernements, monarchique, impérial ou républicain, par l’octroi ou le refus de ses « avances ». « Rois, parlements, presse, […] armée, Église […] meilleurs élèves des grandes écoles », etc., trancha un observateur de 1942 ou 1943, sont « depuis un demi-siècle complètement passés sous le contrôle du haut patronat. [L]es hommes politiques, les ministres, les vénérables des loges et les secrétaires de syndicats, cela ne pèse pas lourd devant le Comité des Forges et le Comité des houillères », qui, avec « les “Deux Cents Familles” » [les 200 plus gros actionnaires de la Banque de France], achètent « la moitié des hommes publics importants ». La longue liste des secteurs par eux contrôlés s’achevait sur le rejet, d’apparence provocatrice, du distinguo entre « démocraties » et États fascistes : « L’État d’aujourd’hui n’est rien devant les trusts. Ni l’État de Lebrun [président de la République depuis 1931], de Daladier, de Paul Reynaud [présidents du Conseil d’avril 1938 à juin 1940], ni l’État de Pétain ni de Laval ni ceux de Mussolini, de Hitler ou de Roosevelt. Derrière tous les rois, chefs d’État et ministres, il y a le haut patronat, dont le public ne connaît pas les chefs, qui n’aiment pas à se faire connaître » (rapport reproduit par les RG de la Sûreté nationale, août 1943).
Pourquoi donc ce « haut patronat français » décida-t-il, si peu après sa si fructueuse victoire de 1918, de balayer une république aussi bonne fille que l’était le nouveau régime pour son homologue allemand ? Seulement par haine des Soviets, auxquels il ne pardonnait pas de lui avoir « fermé l’accès des matières premières » de l’ancien empire : « l’or, le fer, le cuivre, le charbon, le pétrole, etc. », seule vraie « patrie [du…] haut patronat international » ? Malgré l’obsession antisoviétique des vrais décideurs français de l’entre-deux-guerres, « Moscou » n’explique pas seule le « plan d’action […] pour la France » qu’ils conduisirent autour du noyau de « ce que l’on appel[ait] les “Deux cents familles” ».
L’organisation d’une « synarchie »
Une douzaine de personnes s’organisèrent en 1922 en club politique, autoqualifié de « synarchie », pour liquider la république. Car, si obligeante que fût celle-ci, elle n’allait jamais assez vite en besogne, entravée par les moyens de défense des détenteurs de revenus non-monopolistes, ouvriers, fonctionnaires, paysans, petite bourgeoisie capitaliste, partis ouvriers ou de « gauche », syndicats, parlement, dont les décisions, lentes et trop molles, faisaient perdre tant de temps et d’argent. Certes, les bailleurs de fonds patronaux faisaient élire et guidaient de nombreux députés et la quasi-totalité des sénateurs. Mais l’obligation pour ces élus de se faire réélire ralentissait leur exécution de « l’assainissement financier », maître mot de la Banque de France, synonyme de verrouillage de tous les revenus autres que ceux de la haute banque et de la grande industrie.
Ce cénacle financier, grand prêteur à l’Italie, qu’il avait entraînée contre son gré dans la guerre récente, prônait pour ce gros débiteur une formule politique à poigne. Elle seule contraindrait le peuple italien à accepter les conditions impitoyables du remboursement dictées depuis la fin du conflit, solution que les créanciers internationaux, français inclus, firent triompher avec Mussolini fin octobre 1922. « Le haut patronat » français, comme tous ses pairs, britanniques et américains inclus, ne cessa d’exalter le modèle italien avant de trouver (en 1933) la formule politique, meilleure encore, adaptée au règlement de l’énorme « dette [extérieure] » allemande.
« Les milieux financiers rêvaient d’un nouveau système de “synarchie”, c’est-à-dire de gouvernement de l’Europe selon les principes fascistes par une fraternité internationale de financiers et d’industriels. »
Quand la synarchie se fonda, elle était dominée (et le resta) par « la banque Worms, […] grande organisatrice des gouvernements de Vichy », par le mystérieux « groupe de Nervo », employeur de Du Moulin de Labarthète (financier des ligues fascistes de l’entre-deux-guerres puis chef du cabinet civil de Pétain), par la Banque d’Indochine et par l’industrie lourde (avec Peyerimhoff, chef du Comité des Houillères), et des obligés du Comité des Forges dominé par François de Wendel et Schneider. Ces gens financèrent et guidèrent, 1° toutes les ligues fascistes, liées à l’Action française, matrice du fascisme née de la lutte contre Dreyfus, puis 2° la Cagoule dans laquelle, sans disparaître, elles se regroupèrent depuis le tournant de 1935. Leurs ligues essaimaient depuis la victoire fugace, en avril 1924, du Cartel des Gauches du radical Édouard Herriot, qui avait promis l’impôt sur le capital et la laïcité en Alsace-Moselle, mais capitula d’emblée devant le Mur d’Argent.
Dans les années 1920, la synarchie, banque Worms en tête, reine de cette spécialité, conquit et forgea le personnel indispensable au bon fonctionnement de sa future dictature : issu de l’École libre des Sciences politiques, inspection des Finances en tête, sans préjudice du Conseil d’État, et des grandes écoles, Polytechnique au premier chef sans oublier l’École normale supérieure et l’École centrale, ce personnel fournissait déjà les cadres de l’État – et, du côté de l’inspection des Finances, ceux de la haute banque –, après un stage étatique plus ou moins bref. Ces hauts fonctionnaires civils issus d’un sérail dominé par « Sciences Po », et les généraux cléricaux et factieux, détestaient la république et « ne la serv[ai]ent qu’à contrecœur », déplora Marc Bloch dans son Étrange Défaite de 1940.
Le noyau économique dirigeant de la synarchie s’étoffa dans les années 1930. Il était surtout constitué de hauts lieutenants du grand capital, que « le public » ne connaîtrait (si peu) que comme ministres ou assimilés sous Vichy : dans la petite cinquantaine de noms du « rapport sur la synarchie » d’Henri Chavin (un des prédécesseurs de René Bousquet au secrétariat général à la police) de juin 1941 figurent ces non-élus devenus gouvernants, presque tous liés à la banque Worms : tel son directeur général, l’inspecteur des Finances Jacques Barnaud, mais aussi Pierre Pucheu (ancien normalien devenu « directeur des services d’exportation du Comptoir sidérurgique de France et administrateur des Établissements Japy »), François Lehideux (directeur général de la Société anonyme des Usines Renault), Jean Bichelonne (X-Mines, « sorti major de Polytechnique », directeur général de « la Société métallurgique Senelle-Maubeuge »), le polytechnicien Jean Berthelot (ancien chef de l’exploitation du réseau ferré (Paris-Ouest), un des dirigeants de la SNCF, fief synarchiste, sous l’Occupation), les inspecteurs des Finances Jacques Guérard (porté en 1938 à la tête des assurances Worms, administrateur de Japy) et Paul Baudouin (directeur général puis président de la Banque d’Indochine), etc. ; et, seul à n’avoir pas « pantouflé », l’inspecteur des Finances Yves Bouthillier, pilier de l’administration des Finances puis son ministre auprès de Reynaud puis de Pétain.
« Le noyau économique dirigeant de la synarchie s’étoffa dans les années 1930. Il était surtout constitué de hauts lieutenants du grand capital, que “le public” ne connaîtrait (si peu) que comme ministres ou assimilés sous Vichy. »
Un fort ralliement de « gauche » à Pétain
La crise aiguisa la « stratégie du choc » (Naomi Klein) contre les salaires et autres revenus pesant sur le niveau des profits. Elle aviva l’impatience de la synarchie à l’égard du régime, qui décidément l’importunait : ainsi quand, à l’été 1931, il fallut attendre quelques semaines que l’État, même avec le docile Flandin aux Finances, acceptât de prendre à sa charge (celle du contribuable) les coûteuses décisions de la Banque de France sur le règlement de la dette extérieure allemande. Elle l’obligea aussi à étendre son recrutement au-delà des grandes écoles, condition nécessaire pour séduire une partie des masses radicalisées. Elle puisa de notables soutiens dans la gauche anticommuniste, politique (SFIO et radicaux), syndicale (CGT de Jouhaux), franc-maçonne : c’est cet efficace travail de sape qui explique un fort ralliement de « gauche » à Pétain ; mais il est si méconnu de ceux qui négligent les archives originales qu’ils opposent une gauche largement antisémite et « collabo » à une droite vichyste patriote et résistante (comme dans les thèses de Simon Epstein).
De ce volet du recrutement témoignent deux personnages importants, tant avant-guerre (surtout pour le premier) que sous l’Occupation : le socialiste Charles Spinasse, qui apporta au chef idéologique des synarques, Jean Coutrot, autre employé de la banque Worms, un sérieux coup de main dans l’investissement de l’appareil d’État quand son ami Léon Blum en fit, en 1936-1937, son ministre de l’Économie nationale ; et le socialiste et syndicaliste CGT René Belin, lieutenant-successeur du secrétaire général Jouhaux, que son traitant depuis le début des années 1930, Jacques Barnaud, transforma en potiche ministérielle sous Vichy. L’effort aboutit même à la conquête d’un des dirigeants du PCF, Jacques Doriot, qui, espéraient ses mentors, pourrait (en apparence) diriger un parti de masse fasciste : en liaison avec les futurs occupants, fort intéressés à la chose, les synarques lui édifièrent en juillet 1936 un parti, le Parti populaire français ; son Bureau politique, originalité pour un parti censément né du terreau populaire de Saint-Denis, fut peuplé de synarques importants, dont Pucheu. Dès 1934, la synarchie choisit la formule qui offrirait une façade civile et militaire à son pouvoir direct : Laval - Pétain (alors ministres respectifs des colonies et de la guerre). Ce choix, définitif, résista à tous les aléas des six années menant la France à la Débâcle et au putsch de juillet 1940.
« Sous la protection du Reich vainqueur et pillard, Vichy, à un degré qu’on ne peut soupçonner sans consultation des fonds originaux, permit au capital financier d’exercer sans intermédiaire le pouvoir gouvernemental. »
Vichy : les synarques ministres ou l’exercice direct du pouvoir
Sous la protection du Reich vainqueur et pillard, Vichy, à un degré qu’on ne peut soupçonner sans consultation des fonds originaux, permit au capital financier d’exercer sans intermédiaire le pouvoir gouvernemental. En témoigne un commentaire du 7 janvier 1942 du diplomate américain Anthony Joseph Drexel Biddle Jr sur le conseil des ministres de Pétain et Darlan (après Laval, juillet - décembre 1940 et avant Laval, avril 1942 - août 1944), avis d’autant plus intéressant que cet ambassadeur auprès de divers pays occupés représentés à Londres appartenait aussi aux milieux financiers : « Nombre d’entre eux avaient de longue date des liens d’affaires importants et intimes avec les intérêts allemands et rêvaient encore d’un nouveau système de “synarchie”, c’est-à-dire de gouvernement de l’Europe selon les principes fascistes par une fraternité internationale de financiers et d’industriels. Laval était depuis longtemps lié à ce groupe. Darlan, bien qu’il ne fût pas de leur monde, était assez intelligent pour se les associer. S’ils adoraient Laval, ils servaient Darlan, comme ils auraient servi quiconque jouait le jeu. » Au sommet de ce groupe « ne portant d’attention qu’à la défense de [leurs] intérêts » trônaient « de nombreuses grandes banques […] : la Banque nationale pour le commerce et l’industrie (qui était par excellence le groupe de Laval), la Banque d’Indochine (dont Baudouin était le chef), la Banque de Paris et des Pays-Bas. Mais celle qui s’identifiait particulièrement au régime Darlan était la banque Worms et Cie » comme le montrait « un bref examen du conseil des ministres et des secrétaires d’État ».
Des membres de « la clique Worms », Biddle n’exclut que quatre « hommes de Pétain » (en se trompant : ceux-ci étant de longue date liés à la synarchie, tel Joseph-Barthélémy, ministre de la Justice, chef cagoulard, qui avait requis de lâcher l’alliée tchécoslovaque dans un article du 12 juin 1938 dans Le Temps, organe du Comité des Forges) : « Pierre Pucheu (Intérieur) et Yves Bouthillier [Finances] étaient des membres de la clique Worms. Le général Bergeret (secrétaire d’État à l’aviation) était classé par les uns dans l’entourage personnel de Pétain, par les autres dans le groupe Worms. Lui excepté, les secrétaires d’État étaient à un homme près associés à la même clique ». Au « groupe Worms » appartenaient aussi « un grand nombre de fonctionnaires subalternes (surtout les secrétaires généraux) », parmi lesquels Bichelonne : secrétaire général puis, d’avril 1942 à août 1944, ministre de la Production industrielle, il dirigeait aussi le Travail, dont Hubert Lagardelle fut le titulaire officiel entre le départ de la potiche précédente, René Belin, en avril 1942, et le sien, en novembre 1943.
« Pratiquement tout ministère ou secrétariat touchant les affaires économiques était aux mains d’un homme ou d’un autre de la clique Worms. » (d’après un des trois rapports - janvier, mars 1942, novembre 1943 - sur la banque Worms cités par William Langer dans Our Vichy gamble, Amden, Archon Books, 1965, p. 168-169).
Malgré des retraits liés, depuis 1942, aux mutations du rapport de forces militaire et de politique général mais aussi à la certitude de la défaite allemande, cette maîtrise fut maintenue jusqu’au bout. Elle fut symbolisée par Bichelonne, personnage emblématique de la baisse de 50 % du salaire réel des ouvriers et employés sous l’Occupation, et au moins autant par Jacques Guérard. Resté inconnu du public, cet « homme de sang » fut, comme secrétaire général de Laval de son retour à la Libération de Paris, le maître du gouvernement français et le principal interlocuteur de l’occupant.
*Annie Lacroix-Riz est historienne. Elle est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris

/image%2F1489059%2F20230703%2Fob_d3a7c7_capture-d-ecran-2023-07-03-a-19-07.png)





 Des décisions historiques suite aux propositions des communistes pour les familles parisiennes
Des décisions historiques suite aux propositions des communistes pour les familles parisiennes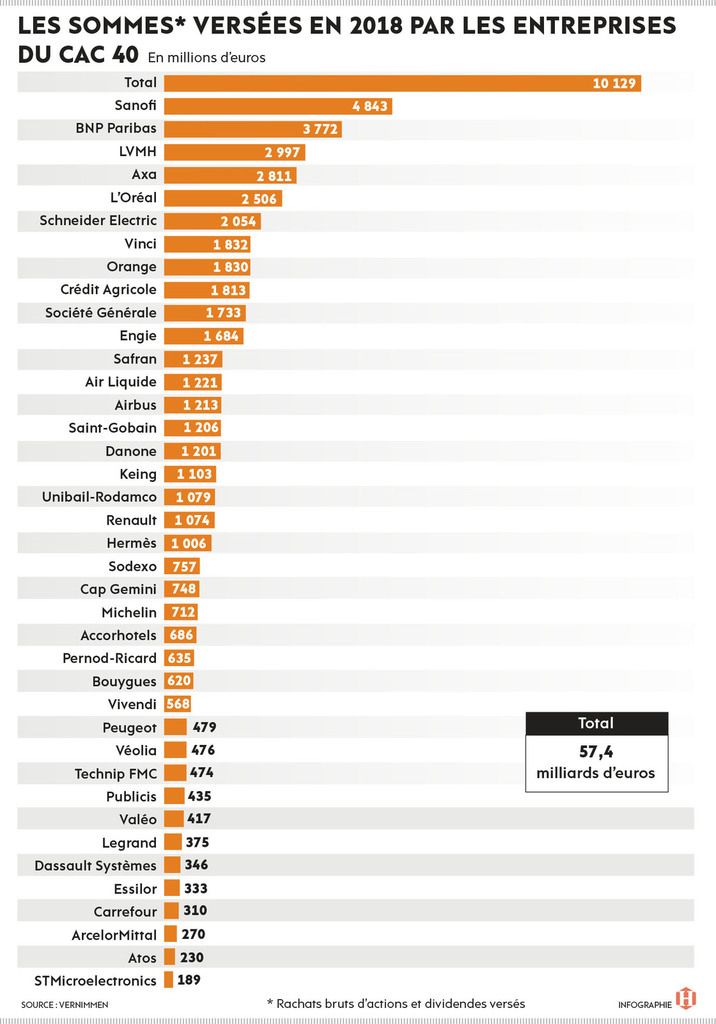







/image%2F1489059%2F20190306%2Fob_5329c2_pcf-section-de-morlaix.jpg)
